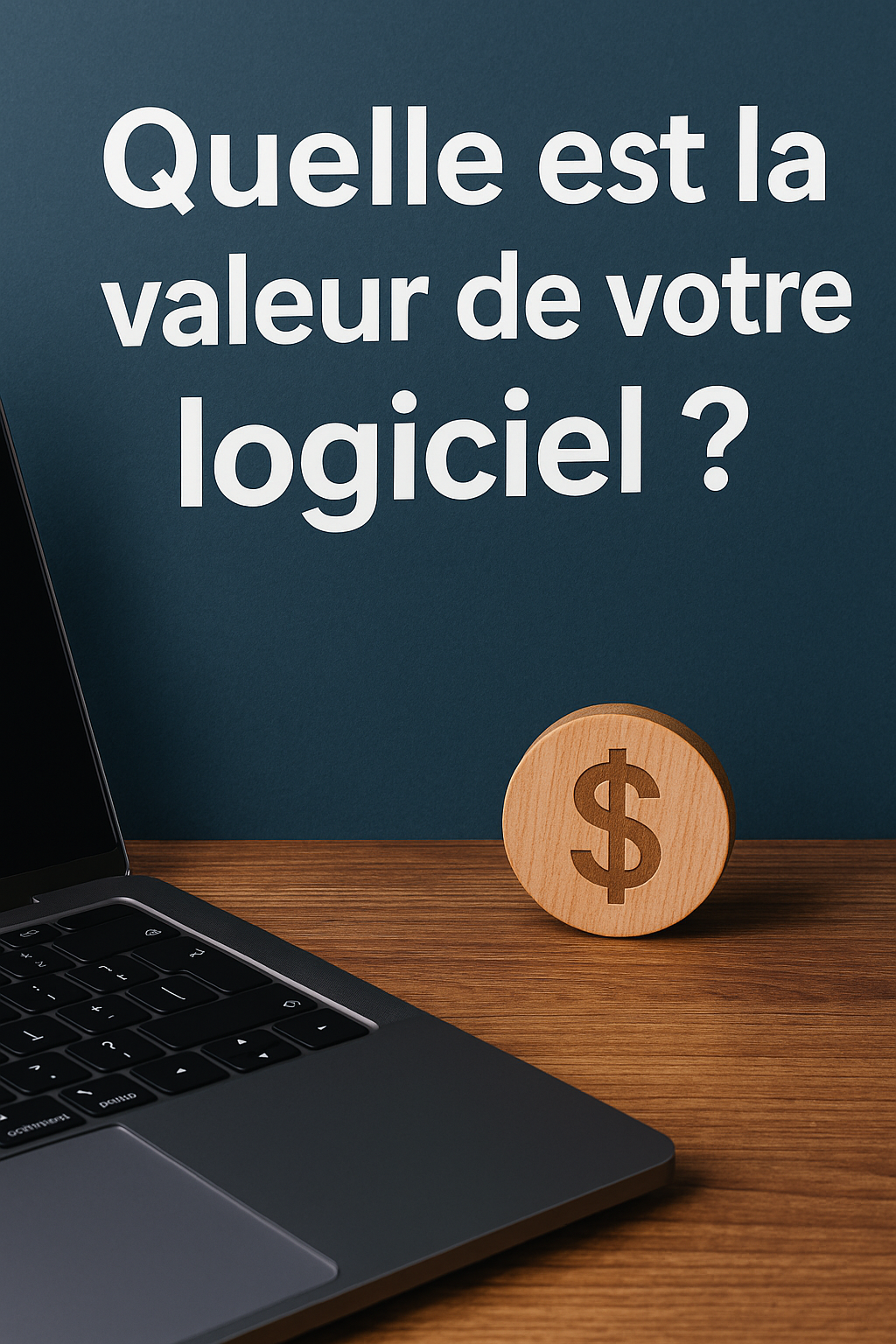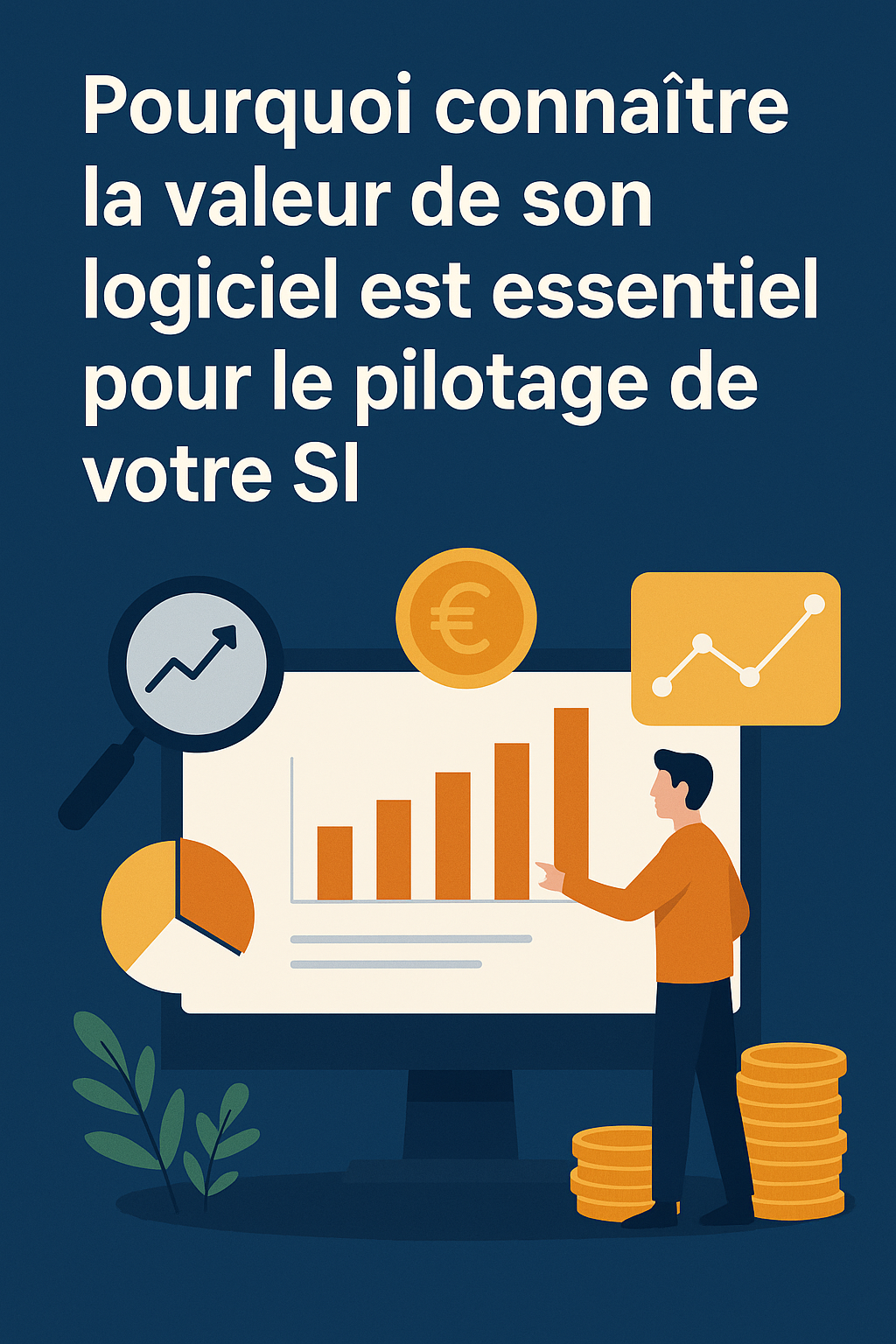Piloter la croissance sans compromettre la stabilité 💼💻
Lorsqu’on parle de qualité logicielle, on pense immédiatement aux développeurs, à l’équipe technique, aux tests, aux outils DevOps… Pourtant, l’un des rôles les plus déterminants dans la qualité d’un logiciel n’est pas technique : c’est celui du CEO.
Un logiciel, ce n’est pas qu’un produit. C’est un actif stratégique. Et sa qualité reflète directement les choix, priorités et arbitrages de l’équipe dirigeante.
Dans cet article, on va voir pourquoi le niveau de qualité d’un produit est rarement supérieur au niveau d’exigence de sa direction, et comment le CEO peut devenir un acteur-clé de la performance technique, sans jamais avoir à écrire une ligne de code.
1. Ce que la qualité logicielle dit de votre entreprise
La qualité d’un logiciel n’est pas seulement une question de bugs ou de performances. C’est une manifestation concrète de votre culture d’entreprise.
Un produit bien conçu, robuste, maintenable, documenté, testé, reflète :
- une organisation structurée,
- des priorités claires,
- une capacité à gérer la complexité,
- une volonté de durer.
À l’inverse, un logiciel fragile, instable, mal documenté traduit souvent :
- une pression court-termiste,
- des objectifs mal alignés,
- un manque d’écoute des équipes tech,
- et une absence de stratégie produit claire.
➡️ En d’autres termes : la qualité technique d’un produit est le miroir des décisions stratégiques.
2. Le premier rôle du CEO : poser une vision claire
Un CEO n’a pas à valider des PR ou rédiger des tests unitaires. Mais il a une responsabilité essentielle : donner un cadre d’exigence et de priorisation.
Voici les questions qu’un CEO devrait se poser (et poser à ses équipes) :
- Quelle promesse client voulons-nous tenir, systématiquement ?
- Jusqu’à quel niveau de fiabilité sommes-nous prêts à aller ?
- Quels types de bugs ou d’instabilité ne sont pas acceptables ?
- Est-on prêt à retarder une livraison si la qualité n’est pas au rendez-vous ?
💡 Ces décisions orientent toute l’équipe, même sans directive explicite.
Un CEO qui banalise les bugs ou exige des livraisons « quoi qu’il en coûte » envoie un message clair : la qualité est optionnelle.
3. Arbitrer la pression client sans sacrifier l’équipe technique
L’un des rôles les plus délicats du CEO est de faire tampon entre la pression commerciale et la réalité technique.
Quand un client exige une fonctionnalité “pour lundi”, le réflexe naturel est de transmettre la pression aux développeurs. Mais cela crée :
- du stress chronique,
- des raccourcis risqués,
- et une dette technique invisible mais exponentielle.
Un bon CEO doit savoir dire :
- « Non, pas à cette date. »
- « Oui, mais avec un périmètre réduit. »
- « Oui, mais on bloque une journée pour fiabiliser juste après. »
En d’autres termes : protéger l’équipe technique, c’est protéger le produit.
👉 Un CEO mature absorbe la pression au lieu de la transmettre. Il crée un espace où la qualité peut émerger, même dans un contexte commercial exigeant.
4. Allouer du temps à la qualité (sans demander la perfection)
L’un des plus grands malentendus autour de la qualité, c’est qu’elle coûterait « du temps ».
En réalité, ce qui coûte du temps, ce sont :
- les régressions,
- les bugs critiques en prod,
- les fonctionnalités gelées à cause d’un code incompréhensible.
La qualité ne ralentit pas. Elle fluidifie.
Mais pour qu’elle existe, il faut que le CEO :
- accepte que tout sprint ne soit pas « rempli » à 100 % de features,
- valide des chantiers de refactorisation ou de documentation,
- mesure aussi les progrès techniques, pas seulement les livraisons visibles.
💡 Exemple : intégrer 15 % de capacité de sprint pour la dette technique est une excellente pratique de gouvernance produit.
5. Créer un environnement favorable à l’excellence technique
Le rôle du CEO est aussi culturel. Il ou elle peut favoriser la qualité de plusieurs façons :
🌱 Valoriser les bons comportements :
- Célébrer un bug évité grâce à un test.
- Applaudir une PR bien documentée.
- Encourager les questions sur l’architecture ou la sécurité.
🧰 Financer les bons outils :
- Analyse statique du code (ex. SonarQube)
- Audit de dépendances open source (ex. Snyk)
- Intégration continue fiable
📊 Suivre les bons indicateurs :
- Taux de bugs en production
- Temps moyen de correction
- Taux de couverture de test sur les modules critiques
La qualité est un système, pas une consigne. Et le CEO est l’architecte de ce système.
6. Pourquoi la qualité logicielle est un enjeu business
Un logiciel de mauvaise qualité ne pose pas seulement des problèmes internes. Il crée :
- une mauvaise expérience utilisateur,
- une image dégradée de la marque,
- une fatigue de l’équipe technique,
- une complexité accrue lors d’une levée de fonds ou d’une cession.
À l’inverse, un produit bien structuré, solide, auditable :
- facilite l’innovation,
- améliore la rétention client,
- réduit les coûts de maintenance,
- augmente la valeur de l’entreprise.
💰 Lors d’un audit technique en M&A, la qualité logicielle peut faire varier la valorisation de manière significative.
Ce n’est pas un sujet “secondaire” : c’est un levier de création de valeur.
Conclusion : le CEO, garant invisible de la qualité
Vous êtes CEO ou dirigeant ? Voici ce que vous devez retenir :
✅ Vous n’avez pas besoin d’être un expert technique.
✅ Mais vous avez un impact décisif sur la qualité du logiciel.
✅ Vos arbitrages, vos priorités, votre manière de gérer la pression façonnent le produit final.
✅ La qualité logicielle est un investissement stratégique qui se décide dès la direction générale.
En assumant ce rôle, vous ne devenez pas un CTO bis.
Vous devenez un CEO qui construit une entreprise pérenne, innovante, scalable.
Et c’est exactement ce que les investisseurs recherchent.